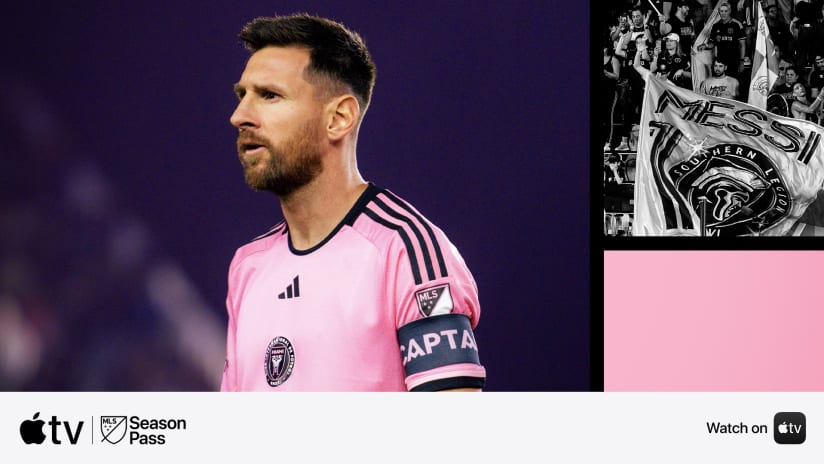La Coupe du monde féminine de soccer a longtemps été l’affaire de quelques pays. États-Unis et Allemagne en tête, suivis par les nations scandinaves, le Brésil, la Chine ou encore le Canada. Mais depuis peu, la France a rattrapé tout ce beau monde. Et pourtant, les demi-finalistes de la dernière Coupe du monde et des derniers Jeux olympiques ne comptent que 80 000 footballeuses. Soit à peine plus que dans… le seul Québec. Au Canada, elles sont 340 000, 250 000 en Allemagne, et environ 1,5 million aux États-Unis. Alors, qu’a fait la France pour avancer plus vite que les autres ?
« Ça a commencé à l’époque de Marinette Pichon, qui a joué plusieurs saisons aux États-Unis et a mené la France à un autre niveau, explique Laetitia Béraud, envoyée spéciale à la Coupe du monde du site footofeminin.fr. Les dirigeants ont vu qu’il y avait moyen de faire quelque chose, et ont constaté l’écart avec les autres pays. »
UN CHAMPIONNAT AVEC DE PLUS GROS MOYENS
Si le championnat de France féminin existe depuis plusieurs décennies, ce sont les clubs de D1 masculine qui ont amorcé le changement. « L’argent vient du masculin. Montpellier est le premier à avoir misé sur le foot féminin, au début des années 2000. Le club a commencé à payer les joueuses à plein temps. Il a dominé le championnat et comme leur équipe masculine aussi était bonne à l’époque, cela a suscité un intérêt pour le foot féminin car les gens se demandaient quel était leur secret. Ensuite, Lyon les a copiés et est passé devant. Et maintenant, avec les Qataris, le PSG consacre un budget de plusieurs millions à son équipe féminine. » Cette année, les budgets annuels de Lyon et du PSG tournent autour des 6,5 millions d’euros (plus de 9 millions de dollars canadiens).
Actuellement en France, il y a donc deux mouvements parallèles. D’un côté, des clubs qu’on pourrait appeler « historiques » du foot féminin, comme Juvisy, qui ont des ambitions mais moins de moyens. De l’autre, le PSG, Lyon ou Montpellier, des clubs dont l’équipe masculine est parmi l’élite. « Le président de ces clubs s’est dit qu’il allait mettre une petite part du budget pour les filles. Dans le budget du club, ça ne représente rien, mais pour les filles, c’est énorme ! »
Et pour cause ! Si à Paris, avec ses riches investisseurs, la part destinée au féminin représente une goutte d’eau (à peine 1,5% du budget du club), même à Lyon, avec moins de 6% consacrés aux filles, on ne se ruine pas. Certains se demandent si les clubs de MLS ne devraient pas prendre exemple, pour solidifier un championnat féminin dans notre coin du monde. Il y a évidemment une réflexion à faire par rapport au budget, bien moindre que celui des clubs européens, pour qui « ça ne coûte presque rien, et apporte une bonne conscience ». Autre comparaison intéressante : le championnat de France se joue d’août à mai. La NWSL, qui représente actuellement le meilleur niveau aux États-Unis, commence à la mi-avril et se termine en août.
Revers de la médaille des nouveaux investissements en France : on y assiste à un championnat à deux vitesses, largement dominé par les équipes les plus riches. Si la situation existe depuis dix ans et n’a pas empêché le niveau de monter, à terme, il faut que cela change. « C’est une limite pour que le foot féminin français franchisse un pallier, estime Claire Gaillard, qui suit l’équipe de France pour L’Équipe, le quotidien sportif de référence en France. Il y a un besoin d’expérience répétée du haut niveau. L’exemple qui l’illustre le mieux, c’est le point faible de l’équipe de France : pas étonnant que ce soit la gardienne. Le vivier est moins grand ; en championnat, elle ne peut pas progresser car son équipe gagne sur des scores fleuves et elle ne voit presque jamais le ballon. Seule la Ligue des champions lui permet de s’améliorer. »
L’EXPÉRIENCE ET LE BAROMÈTRE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS
En effet ! Le championnat n’a pas tout fait à lui seul. Depuis 2001, les meilleurs clubs européens s’affrontent en Ligue des champions. Quand on demande aux joueuses la raison des progrès français, elles citent toutes la compétition internationale. « En France, c’est devenu de plus en plus professionnel. Désormais, tout le monde s’entraîne dans de bonnes conditions. Jouer la Ligue des champions nous a aidées à gagner en expérience », déclare par exemple la gardienne titulaire des Bleues, Sarah Bouhaddi.
« Au début, il y avait de gros écarts, reprend Laetitia Béraud. Et puis, en 2010, on s’est rendu compte qu’il y avait plus de suspense durant les rencontres et, l’année suivante, Lyon a gagné la Ligue des champions ! Cela ne bénéficie pas qu’aux clubs français. C’est un vrai test pour tous les championnats européens et pour les grands clubs, comme Chelsea ou Barcelone. C’est ce qui permet réellement de savoir où on en est dans le foot féminin. » Une compétition internationale de clubs, encore un avantage concurrentiel pour les Européennes par rapport aux Américaines et aux Canadiennes.
Seul défaut, relatif, de cette Ligue des champions : l’élite féminine européenne se résumant souvent aux mêmes clubs, l’écart se creuse avec leurs poursuivants dans leurs championnats respectifs. Il y aurait peut-être une solution. « Ce qui est dommage, c’est qu’il n’y ait rien en-dessous, comme l’Europa League chez les messieurs. Cela constituerait une motivation supplémentaire pour les clubs qui sont un cran juste en-dessous, d’autant qu’en championnat, ils se retrouvent systématiquement derrière les grands. »
LES VOLONTÉS DE LA FÉDÉRATION
Un championnat avec plus de moyens, une compétition internationale pour gagner en expérience : si les progrès passent par les clubs, il ne faut pas négliger le rôle de la Fédération. « 2011 a été un révélateur, explique Claire Gaillard. Lors de la Coupe du monde en Allemagne, le président de la Fédération Noël Le Graët assistait pour la première fois à du foot féminin. Et il jalousait l’Allemagne. Il a lancé un plan de féminisation du football féminin. Avant 2011, l’équipe de France, c’était du pur amateurisme. Il y avait très peu de licenciées, elle n’était pas suivie et ne bénéficiait pas d’une préparation aussi professionnelle qu’aujourd’hui. Le beau parcours de 2011, c’était surtout grâce à Lyon et à Juvisy. Dans les autres clubs, les joueuses étaient généralement à mi-temps et combinaient le football avec un autre travail ou des études. »
ÉCOUTEZ COUP FRANC : HISTOIRE DU SOCCER FÉMININ AU QUÉBEC
De l’équipe de France A aux petites filles qui frappent dans leurs premiers ballons, la Fédération française de football a couvert toutes les sphères du soccer féminin. De 45 000 joueuses il y a 4 ans, l’objectif est d’atteindre les 100 000 fin 2016. Des structures sont mises en places. Et les moyens mis à la disposition de l’équipe de France féminine sont de plus en plus comparables à ceux de leur homologue masculine. Voilà qui en dit long sur la marge de progression des Françaises, puisque ce plan ne portera complètement ses fruits que dans quelques années.
PROGRÈS TACTIQUES, PROGRÈS PHYSIQUES
Malgré tout, en 2011, une chose avait déjà sauté aux yeux de tous les observateurs : alors que dans le soccer féminin, le kick and rush et le jeu physique constituaient la norme de réussite des grandes nations depuis 20 ans, la France a régalé les observateurs grâce à son jeu collectif tout en combinaisons. « La raison est simple : la France a toujours aimé le beau jeu. On a insisté sur la qualité technique… comme on le faisait chez les garçons. C’est une philosophie française de “vouloir jouer”. En plus, il y a peu de fautes chez les filles, et ça amplifie l’efficacité du phénomène. »
« L’ancien sélectionneur Bruno Bini a décrété que l’avantage de mieux maîtriser les aspects tactiques pouvait faire une différence, renchérit Laetita Béraud. Mais en championnat de France, il n’y a quand même que quatre équipes qui les maîtrisent, les autres jouent toujours du kick and rush. Avant, la France jouait aussi du kick and rush… car tout le monde faisait ça. »
Ces progrès tactiques ne sont pas venus seuls. Les circonstances sont aujourd’hui plus favorables pour travailler. « La médiatisation du foot féminin permet d’avoir plus d’informations. Avant, on avait du mal à connaître notre adversaire, c’était donc difficile de développer une tactique en fonction de lui. En plus, le physique suffisait alors à faire la différence. »
Mais c’est un cocktail complet qui a permis aux Françaises de tutoyer les meilleures. « Le savoir-faire des garçons a été appliqué aux filles. Bergeroo a amené la tactique, les filles avaient déjà une très bonne technique ; physiquement, elles sont encore en-dessous, mais ça se rattrape. Comme elles sont professionnelles désormais, elles ont le temps pour faire de la musculation, et après trois ans, ça paye. »
« Physiquement, on a progressé, confirme l'attaquante Eugénie Le Sommer, une des vedettes de l'équipe de France, interrogée sur l’écart qui se comble avec les Allemandes. On a nos qualités techniques, et notre style de jeu peut les embêter. »
Il y a également une mentalité particulière. Venu du soccer masculin, le sélectionneur actuel Philippe Bergeroo a découvert un univers auquel il ne s’attendait pas. « Les filles connaissent le foot, et le suivent, explique l’ancien gardien de but qui a participé à la Coupe du monde 1986. Si on parle des matches de championnat anglais du week-end et que je me trompe sur un truc, je me fais immédiatement reprendre ! Lors de nos séances vidéo, elles ne veulent pas que je leur montre ce qui a bien été dans le match, elles veulent le négatif ! Il y a une volonté permanente de s’améliorer. » À l’issue de la première de ces séances, il a été tout surpris de voir la plupart des joueuses venir vers lui avec leur clef USB et demander les images, afin qu’elles puissent les revoir à l’envi par la suite !
DES SALAIRES QUI FACILITENT LE CHOIX DE CARRIÈRE
Une mentalité de pro, donc, et désormais dans un environnement professionnel, nous explique la journaliste de L’Équipe. « Si le contrat des joueuses en club n’est pas appelé pro, à mes yeux, elles le sont puisque le foot est le métier auquel elles se consacrent à plein temps : entraînement, préparation physique, matches, etc. Ça a permis de progresser, et le recrutement de joueuses internationales a amené de l’expérience, d’où de meilleurs parcours en Ligue des champions. Cela se répercute sur l’équipe nationale, qui en profite. »
Chiffres à l’appui, cela reste impressionnant, surtout quand on part du principe qu’en NWSL, le salaire annuel maximal est de 37 000 dollars américains (44 000 dollars canadiens). À Lyon, le salaire mensuel moyen est de 10 000 euros par mois, à Paris de 7000 (respectivement 14 000 et 10 000 dollars canadiens). L’internationale Lotta Schelin, joueuse la mieux payée du championnat, perçoit mensuellement 17 000 euros. En comparaison, seuls six joueurs de l’Impact de Montréal ont eu un plus gros chiffre sur leur fiche de paye en 2014 ! Si le Paris Saint-Germain avait remporté la Ligue des champions, chaque joueuse aurait reçu une prime de 5000 euros.
Même certains clubs plus modestes offrent des salaires mensuels entre 3000 et 5000 euros à la plupart de leurs titulaires : pas assez pour mener la grande vie de certains sportifs professionnels ni pour constituer un viatique pour son après-carrière, mais suffisamment pour être aussi bien payé que dans de nombreuses autres professions. Sans oublier que les joueuses ont des temps libres leur permettant d’avoir une autre source de rémunération à temps partiel.
« Juvisy est semi-pro : le temps de travail des joueuses y est aménagé pour qu’elles ne doivent pas s’entraîner en soirée. Des clubs comme Guingamp ou Montpellier ont une organisation qui facilite la pratique du football. Beaucoup de joueuses allemandes qui viennent en France nous disent que les salaires y sont comparables : ceux de Wolfsburg, le club allemand au plus gros budget, sont environ les mêmes qu’au PSG. »
Avec de tels moyens, il y a évidemment moins d’hésitations au moment du choix de carrière. « Marie-Laure Delie (27 ans) explique que plusieurs de ses anciennes coéquipières très talentueuses ont arrêté, car à l’époque, on ne leur proposait pas plus de 400 euros par mois. C’était trop contraignant. L’idée, désormais, est que les filles ne passent pas à travers. Il y a moins de problèmes d’impératifs de vie. Elles sont prêtes à partir de chez elles. Elles attendent la fin de leur carrière pour avoir des enfants. Pour un joueur, avoir un enfant à 20 ans n’a pas de répercussions aussi directes… »
LA FORMATION DES JEUNES PROGRESSE À GRANDS PAS
Chez les jeunes aussi, la situation a beaucoup évolué ces dernières années. Peu nombreuses, les joueuses n’ont longtemps pas eu la vue facile. « De plus en plus de clubs ont une structure féminine, mais le chemin est encore long. À de rares exceptions près, les joueuses qui sont ici à la Coupe du monde ont toutes commencé à jouer avec les garçons, car il n’y avait pas de structure pour les accueillir quand elles étaient jeunes. Aujourd’hui, ce n’est plus vraiment le cas. »
« En France, s’il n’y a pas d’équipe féminine, on joue en mixte jusqu’à 13 ans, mais après ce n’est plus possible, précise Laetitia Béraud. Le jour où il n’y aura plus de filles qui joueront avec des garçons, ça pourrait être considéré comme une victoire puisque ça voudrait dire que suffisamment de filles jouent. Mais il y a 15 ans, à la fin du mixte, les 15-18 ans devaient attendre l’universitaire pour retrouver quelque chose. Étonnamment, c’était un problème juste pour le football, pas pour d’autres sports comme le handball ou le volley. »
Comme aux États-Unis, les universités ont donc été un vivier de joueuses. Une situation désormais révolue. « Il y a 10 ans, l’universitaire, où on arrive vers 18-19 ans, constituait une réserve de recrutement pour les clubs de D1. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Si tu es bonne à 15 ans, tu intègres les équipes de jeunes d’un bon club. »
Entre temps, la Fédération a mis sur pied des pôles espoirs, permettant aux meilleures joueuses de combiner sport de haut niveau et études. « Ils ont permis d’avoir une structure complète pour les équipes nationales de jeunes, explique Claire Gaillard. Avant, derrière l’équipe nationale A, il n’y avait pas souvent grand-chose. En plus, ces équipes sont maintenant supervisées par d’anciennes internationales, comme Sandrine Soubeyrand. »
Si désormais, la France est bien représentée sur la scène internationale dans les catégories d’âge, ses joueuses viennent de moins en moins de ces pôles espoirs. « Étant donné que les clubs sont de plus en plus structurés, ils sont de moins en moins nécessaires. Les clubs s’associent à des établissements scolaires où vont toutes leurs joueuses, pour former des sports-études. »
Ce qui n’empêche pas la Fédération de veiller sur ces joueuses comme sur la prunelle de ses yeux. « Ça n’a pas trop bougé entre le groupe des -17 ans en 2012 et celui des -20 qui était ici l’an dernier. La Fédération les chouchoute : elle ne peut pas se permettre de perdre des talents, le choix n’est pas assez large, le vivier n’est pas assez grand. »
CONCLUSION
Efforts financiers et meilleure organisation des clubs, compétitions plus relevées sur la scène nationale et internationale, énorme volonté de la Fédération, salaires qui permettent de vivre décemment en se consacrant pleinement au soccer et formation qui facilite un développement optimal : le visage du soccer pratiqué par les filles a considérablement changé en quelques années en France.
Les résultats se voient sur le terrain. Qu’on ne s’y trompe pas : le mouvement n’en est qu’à ses prémices, d’autant que la France organisera la Coupe du monde en 2019. Tout le monde y est conscient qu’il y a encore une énorme marge de progression. Et s’il n’y a pas si longtemps que cela, les États-Unis faisaient figue de modèle, désormais, ce n’est plus de notre côté du monde que l’on cherche les exemples pour aller de l’avant. Il n’y a qu’à constater l’enthousiasme d’Eugénie Le Sommer lorsqu’elle déclare : « En Allemagne, le foot féminin est tellement développé ! Elles ont tout pour elles : que ce soit en nombre de licenciés, dans les clubs, c’est ce qui se fait de mieux en Europe. Mais on se rapproche ». La révolution du soccer féminin est en marche, et gare à ceux qui rateront le train !
Lectures complémentaires : J’ai rêvé d’être footballeuse, le parcours des championnes françaises d’aujourd’hui – Paroles de pionnières, ces Françaises qui ont promu le soccer féminin aux États-Unis il y a 40 ans.